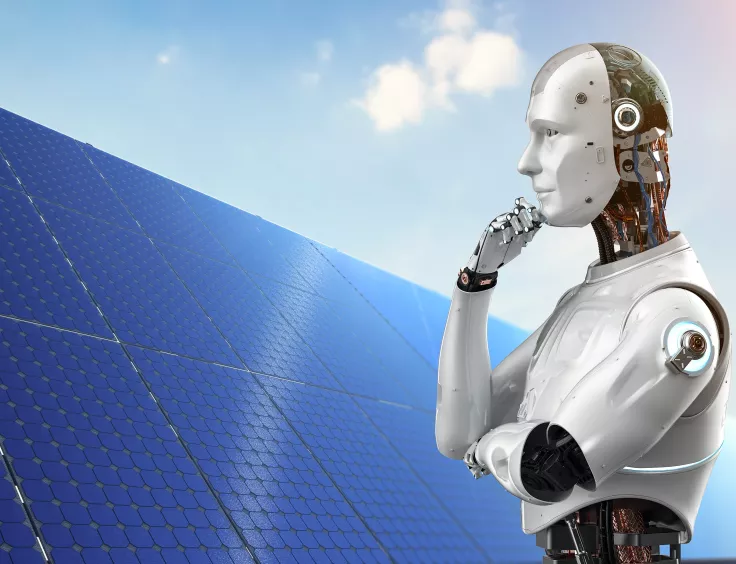La géothermie profonde

Contrairement à la géothermie dite de surface, qui exploite préférentiellement la chaleur de la roche sèche, celle des moyennes et grandes profondeurs est plus rarement utilisée en Suisse à cause d'une exploitation plus difficile.
À notre connaissance, seules quelques centrales géothermiques issues d’un forage profond sont en service dans notre pays, à l’image de celui de Riehen, dans le canton de Bâle, qui fournit de la chaleur à plus de 8.000 habitants, et ce depuis 1994…
À titre de comparaison, chez nos voisins français et allemands, la géothermie des moyennes et grandes profondeurs est beaucoup plus développée, et depuis bien plus longtemps...
Dans la région d’ile de France, cinquante centrales géothermiques de moyennes profondeurs alimentent près d’un million d’habitants, des complexes qui datent des années 80 !
En Allemagne, plusieurs dizaines de centrales géothermiques produisent de la chaleur et de l’électricité, notamment dans le fossé rhénan et le bassin munichois, et des centaines de forages exploratoires sont en cours…
Et pourtant, au pays du hâte-toi lentement, on dirait que cet adage évolue lui aussi…
En effet, coup sur coup, deux cantons romands, Genève et Vaud, se décident à cartographier systématiquement leurs sous-sols au moyen de camions- vibreurs, et lancent d’ambitieux projets exploratoires de forage profond !
De quoi parle-t-on exactement ?
En Suisse, il s’agit d’aller chercher en profondeur la chaleur du sol, souvent contenue dans des aquifères, de l’extraire, et ensuite de la renvoyer un peu plus en aval, dans le même aquifère, afin de ne pas déstabiliser le sol, selon le principe du doublet géothermique.
Et rappelons ce principe presque immuable en géothermie : plus l’aquifère est profond, plus chaude sera l’eau, et plus l’extraction de son énergie sera profitable, quel que soit l’usage qui en sera fait...
Et le potentiel est immense.
Selon la profondeur où se trouve l’aquifère (entre 300 et 3,000 mètres) selon la composition des couches géologiques du sol, en Suisse l’eau peut atteindre une température de 35 à 110 degrés, rarement plus.
Avec cette température, on chauffe un village, un grand quartier, ou des installations agricoles comme des serres ou une pisciculture.
Notons toutefois que, selon le volume de l’aquifère et la quantité d’eau pompée, la nappe peut se refroidir graduellement en quelques dizaines d’années (de 30 à 100 ans) ce qui peut rendre la production de chaleur moins efficace avec le temps.

En forant encore (entre 4000 et 6000 mètres) on atteint le domaine de la géothermie des grandes profondeurs : là, les températures de la roche peuvent atteindre voire dépasser les 200 degrés !
Si un aquifère est présent, on peut directement exploiter l’eau semi-gazeuse à haute température. Sinon, en injectant de l’eau sous pression dans le canal de forage (fracturation hydraulique) on améliore la perméabilité de la roche en créant une cavité.
Ensuite, en injectant de l’eau de surface (froide) dans cette cavité, on crée un cycle de réchauffement induit par la température de la roche.
Enfin, par pompage à l’aide d’un autre forage, on remonte cette eau chaude dans un échangeur de chaleur, et l’énergie thermique se transforme en gaz sous pression, ce qui permet d’actionner un turbogénérateur (une turbine à vapeur couplée à un alternateur) pour produire de l’électricité.
C’est justement cette technique de fracturation hydraulique qui est susceptible de produire des séismes induits, comme à Bâle en 2017, mais ce phénomène est mesurable et contrôlable, notamment en utilisant les techniques mises au point par l’industrie pétrolière qui se trouva confrontée aux mêmes phénomènes.
D’ailleurs, l’entreprise GEO énergie suisse expérimente actuellement, dans la cadre d’un projet pilote, un système dit « multifracture » à Haute-Sorne, dans le canton du Jura.
Cette nouvelle technique de fracturation hydraulique agit transversalement, par petites poussées, en évitant la possible formation d’une onde sismique de grande ampleur, susceptible de provoquer des dégâts en surface.
D’ailleurs, à lui seul, ce projet pilote illustre le véritable parcours du combattant qui fut imposé à cet essai, un mélange typiquement helvétique d’oppositions, de recours, et d’initiative populaire qui mit plus de dix ans à être levé…
Comme toujours, les énergies renouvelables, bien sûr, mais « not in my backyard ! »
Et pourtant, dans notre pays comme dans presque tous les autres, le potentiel de la géothermique, notamment profonde, est l’une des clefs d’un mix énergétique compétitif et largement décarboné.
Mais pour l’exploiter, il faudra obligatoirement effectuer une pesée d’intérêt…
Si, on l’a vu, la géothermie des grandes profondeurs est relativement complexe à mettre en œuvre, et coûteuse à réaliser, ce n’est certainement pas pire qu’une centrale nucléaire, ou même qu’un grand barrage ! Des ouvrages qui, avec la mentalité actuelle, ne seraient peut-être même plus réalisables, du moins dans un délai convenable…
Quelques risques sismiques légers, et maîtrisables, contre la promesse d’une énergie renouvelable discrète, permanente, locale, propre et quasiment inépuisable, complément idéal des autres énergies renouvelables plus fluctuantes, cela devrait parler à tout le monde !
Et pourtant !
À notre connaissance, sur la dizaine de projets en cours prévoyant d’exploiter la géothermie des grandes profondeurs, tous sont à l’arrêt ou presque, à l’exception de ceux de Haute-Sorne, et de Vinzel.
Combien d’été caniculaire et d’épisodes de sécheresses majeures faudra-t-il encore pour que le principe de précaution soit réévalué à cet aune qui représente une urgence certaine ?
Parce que, toujours au sujet de la géothermie, et cette fois toutes profondeurs confondues, il est un autre secteur où ce principe de précaution gagnerait à être réévalué, celui de la protection des nappes phréatiques ou des aquifères souterrains…
Si la base de ce principe ne souffre d’aucune contestation — l’eau est vitale pour tous et doit être préservée — les interdictions de forages sont parfois érigées en dogme, sans examen des nouvelles solutions techniques éprouvées qui pourraient garantir l’intégrité de la ressource à protéger.
Certes, il fut un temps d’insouciance énergétique où cette solution de facilité était tentante : on identifiait la zone probable d’un aquifère, on l’étendait un peu par sécurité, et on la passait en zone rouge, interdite au forage, donc à la géothermie.
Cette solution intégrale avait pour mérite sa simplicité, son efficacité aussi...
Certes, mais à quel prix ?
Combien de quartiers de villes ou de villages entiers sont exclus du formidable potentiel géothermique du sous-sol ? Combien d’émission de carbone en plus ? Pour quels coûts ?
Et l’idée n’est pas de brader l’indispensable protection des eaux, mais de mettre à profit les dernières techniques en la matière pour nuancer les interdictions, voire les lever quand un forage exploratoire sécurisé, par exemple, aura prouvé qu’elles étaient excessives, voire injustifiées.
Cependant, parfois, ces forages exploratoires ne sont même pas autorisés, puisqu’on ne fore pas en zone rouge…
Ce type de raisonnement, résolument passéiste, prévaut encore dans trop de communes, voir de canton, où des zones parfois très étendues sont interdites à la géothermie par des décisions prises il y a une, deux, voire trois décennies, et jamais réévaluées depuis…
C’est oublier que si la géothermie à faible profondeur progresse en Suisse, et qu’une réglementation fédérale favorable aide à son développement, un peu que moins de 2 % des besoins totaux de chauffage sont assurés par la géothermie, alors que le potentiel est sans doute dix à vingt fois plus élevé !
Et même si l’on excepte le volet réglementaire et pour prometteuse qu’elle soit, la géothermie des grandes profondeurs n’est pas exempte d’écueils, parfois rédhibitoires :
En premier, les techniques actuelles d’auscultation des sols (tomographie sismique ou électrique, notamment) ne permettent pas de certifier la présence d’aquifères en profondeur, et encore moins leur débit, mais seulement de le suggérer.
Un forage exploratoire est donc toujours nécessaire et, à grande profondeur, ce type de travaux est coûteux, voire très coûteux, et ce d’autant qu’il peut aboutir sur… rien ou presque !
À titre d’illustration, en 2022, le projet vaudois de géothermie profonde de Lavey les bains, atteignait à plus de 3.000 mètres une nappe d’eau certes chaude (110 degrés) mais son débit était insuffisant pour assurer le chauffage d’un millier de ménages, comme le prévoyait le projet…
Ce semi-échec à 40 millions de CHF est révélateur des difficultés de la géothermie à moyenne ou grande profondeur : le coût des forages est élevé, et l’incertitude est grande.
Saluons quand même la pugnacité du canton de Vaud qui, à peine démantelée, transfère la plate-forme de forage de Lavey à Vinzel, au pied du Jura, pour un autre essai de même nature sur un site qui s’annonce lui aussi prometteur !
Ce n’est qu’avec ce type de volonté politique et d’essais, allié à un cadre réglementaire adapté, que l’on pourra apprendre à « lire » le sous-sol de façon plus fiable, puis à le cartographier afin d'établir la géothermie comme la part importante du mix énergétique décarboné qu'elle devrait être.